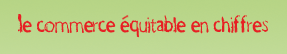> Le commerce équitable
Plan du TPE :
a) Qu’est-ce que le commerce équitable et dans quel but ce concept a-t-il été créé ?
b) Quels sont les apports positifs de ce type de commerce pour les économies sous-développées ?
c) Quels sont les problèmes rencontrés et les limites de ce système ?
II. Du petit producteur au consommateur
a) Du cacao au chocolat équitable
b) La coopérative El Ceibo en Bolivie
Introduction
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Le commerce mondial, dans son organisation actuelle est inéquitable. Son mode d’organisation connaît des dysfonctionnements. Les pays touchés sont évidemment les plus vulnérables : les pays sous-développés et particulièrement les petits producteurs sont ciblés. Ces dysfonctionnements sont liés à des facteurs locaux tels que la dispersion et la désorganisation des petits producteurs, auxquels les prix sont dictés par des organisations d’acheteurs puissants. Cependant des facteurs internationaux doivent également être pris en compte. On peut citer l’importance des variations des cours des matières premières, avec des prix qui décroissent systématiquement tandis que les prix imposés par les pays du Sud augmentent sur le marché mondial. Il faut aussi savoir que les exportations venant du Sud sont constituées de 80% de matières premières agricoles, et qu’il existe des barrières protectionnistes à l’importation et des subvention aux producteurs des pays riches (fortes pressions sur les salaires, ainsi que sur les conditions de travail des ouvriers). On observe également qu’il n’existe aucune volonté de solidarité au niveau international telle que celle mise en place au sein de l’Union Européenne avec la P.A.C.. Tous ces facteurs ne tendent qu’à accentuer les écarts de développement entre pays riches et pays pauvres. L’économie mondiale est donc une économie à deux vitesses.
Pour palier à ces inégalités et comme la seule loi du marché ne peut suffire à régir les relations entre les êtres humains, une alternative s’impose. C’est ainsi qu’un nouveau concept émerge dans les années 60 sur l’initiative d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) en Angleterre et aux Pays-Bas : LE COMMERCE ÉQUITABLE. Fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, le commerce équitable vise à plus de justice et d’équilibre dans le commerce mondial. C’est une organisation différente des échanges commerciaux, tournée vers l’homme.
I. Le commerce équitable
a) Qu’est-ce que le commerce équitable et dans quel but a-t-il été créé ?
L'idée du commerce équitable n'est pas nouvelle. En 1964, lors de la CNUCED, on appelait pour la première fois à des conditions plus justes du commerce : « Trade, not aid ». Quelques années plus tard, en 1987, le rapport Brundtland (du nom de son auteur, Gro Harlem Brundtland), intitulé également “Our commun future” donnait naissance à un nouveau concept, une nouvelle manière d’appréhender les enjeux humains : le développement durable. Celui-ci consiste à favoriser un modèle de croissance aujourd’hui, qui n’hypothèque pas la capacité des générations futures à répondre aux enjeux de demain. Au niveau des pratiques commerciales, 2 types d’initiatives de développement durable sont prises : le commerce éthique et le commerce équitable, démarches qui ne sont pas opposées mais complémentaires. Les premiers acteurs à s’être engagés dans la voie du commerce équitable, dans les années 1950-1960, furent des associations de solidarité internationales qui menaient déjà des projets de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement appelés plus couramment pays sous-développés. Entre 1970 et 1990, cette demande est relayée par les ONG du nord (Oxfam en Grande-Bretagne, Max Havelaar aux Pays-Bas). Le mouvement se poursuit en Europe (Allemagne, Suisse, France) et enfin au Japon, aux États-Unis et au Canada. Il se fait aujourd’hui connaître par les médias, les intervenants du commerce équitable et par une réflexion des populations sur les valeurs citoyennes.
Le commerce équitable est un commerce social dont le but n’est pas la recherche du profit maximal mais l’aide au développement. C’est en fait le modèle de la P.A.C. que l’on a cherché à imiter mais à une échelle plus large. Ce commerce a pour principe d’aider des coopératives d’artisans dans les pays en développement à se développer de manière durable . Pour cela, il garantit à ces petites coopérations de bénéficier d’un prix juste pour leur travail afin de leur permettre de mieux répondre à leurs besoins fondamentaux ( amélioration des conditions de vie en terme de santé, d’éducation, de logement, mise en place de projets de développement de leur communautés).
Le système du commerce équitable n’obéit pas aux règles du marché classique. Le directeur de l’association Max Havelaar explique que ce commerce garantit aux producteurs un contrat à long terme et la fixation d’un prix minimum pour éviter la fluctuation des cours. La banque mondiale prône également le recourt au marché à terme, dont le but est de prévenir les producteurs des variations des prix. La vente se fait sans intermédiaires et la production est en partie préfinancée pour éviter le recourt à des crédits exorbitants. Le développement et l’exportation d’un produit ne doivent en aucun cas compromettre la sécurité alimentaire locale. Tous les acteurs s’engagent véritablement à respecter les principes du commerce équitable, le besoin de transparence et l’importance de la sensibilisation et du lobby (groupe de pression). L’idée de “main invisible*” se transforme ainsi en “main dans la main”. Situé dans le chapitre de l’économie solidaire, le commerce équitable est un système d’échanges respectueux du travail des hommes et de l’environnement et qui concourt au développement durable de notre planète. La spécificité fondamentale du commerce équitable est celle d’un partenariat fondé sur l’égalité et le respect - partenariat entre les producteurs du Sud et les importateurs du Nord, les magasins du commerce équitable, les organisations de labellisation et les consommateurs. Le commerce équitable “humanise” le processus commercial. Il raccourcit le plus possible la chaîne producteur / consommateur. Actuellement, le commerce équitable porte essentiellement sur des produits de base tels que le café, le thé, le cacao, les bananes, etc., ainsi que sur des produits artisanaux comme la confection (textile), la poterie, la vannerie, etc. Les lieux de production se situent en Amérique Latine (pays de coopération traditionnelle des Pays-Bas et de l’Allemagne). Le commerce équitable se divise en deux filières. D’une part, la filière intégrée limite au maximum le nombre d’intermédiaires : les distributeurs achètent directement auprès des producteurs et revendent directement aux consommateurs par le biais des magasins du monde. D’autre part, la filière « labellisée », organisme de certification, intervient dans le circuit précédent. Il repose sur la garantie de produits de qualité en échange du respect des principes du commerce équitable. Ce commerce est caractérisé par :
- une juste rémunération du travail, qui satisfait les besoins vitaux en priorité, besoins inférieurs, d’après la pyramide de Maslow, mais également des besoins plus secondaires
- le respect des droits fondamentaux des personnes
- des relations durables entre partenaires économiques
- la préservation de l’environnement
- des produits de qualité qui répondent aux attentes du consommateur du Nord
- la possibilité d’adopter de nouveaux comportements de consommation.
En contrepartie, le producteur s’engage à fournir un produit de qualité, à respecter les normes sociales établies par l’O.I.T ( Organisation Internationale du Travail) et à consacrer une partie du produit de la vente à des projets de développement.
Les producteurs doivent avoir la possibilité de transformer le plus possible le produit sur place avant de l’exporter. Ils bénéficient ainsi de la plus-value du produit et peuvent acquérir des moyens techniques supplémentaires. Il est également important d’insister sur le rôle des femmes dans le processus de prise de décision, à la fois dans les groupes de producteurs du Sud et dans les organisations de commerce équitable au Nord. Le respect de l’identité culturelle de chacun des partenaires est également exigé dans le mouvement. Pour les organisations et les magasins de commerce équitable, l’absence d’un des critères de partenariat n’empêche pas un groupe de producteurs du Sud de devenir partenaires. Les types de producteurs, les produits, les réalités économiques et sociales sont très diversifiés. Chaque groupe de producteurs est donc traité au cas par cas. Dans le processus de sélection, les producteurs ne doivent pas avoir acquis les critères optimaux dès le départ. Leur volonté de les atteindre et celle du partenaire du Nord de l’aider dans cette évolution sont plus importantes. Cependant, par leur nature, les initiatives de labellisation du commerce équitable doivent garantir aux consommateurs les critères convenus. Si un certain degré de souplesse est possible pour refléter la spécificité d’un produit, une fois les critères établis, le producteur doit les atteindre tous sans exception.
Si ce concept a été créé, c’est pour des raisons multiples. Le commerce équitable a d’abord été créé avec la volonté, certes ambitieuse, de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde. Le but du commerce équitable est de libérer les petits producteurs du joug des multinationales en leur ouvrant de nouveaux débouchés ; et ensuite d’aider le producteur à retrouver un prix suffisamment rémunérateur de son travail. De plus, l’autonomie des producteurs, l’apprentissage du développement, le renforcement des organisations entre producteurs, l’aide à l’amélioration de la santé et de l’éducation, ainsi que l’ouverture des perspectives politiques, sont autant d’objectifs que le commerce équitable s’est fixé. Les producteurs doivent aussi chercher à établir un équilibre entre l’accès au marché local et au marché d’exportation (équitable ou autre). Le commerce équitable existe également pour informer les consommateurs et lui permettre d’effectuer un achat fondé et responsable, pour changer les règles et les pratiques du Commerce International.
Quant aux consommateurs, acteurs essentiels qui se doivent de participer activement au commerce équitable, ils sont tenus de changer de comportement par rapport à leurs habitudes de consommation, de prendre conscience que chacun devrait participer à ce concept, de comprendre les différences Nord-Sud. Cela leur permettra d’avoir une action concrète et engagée à leur niveau, de modifier les rapports économiques dans le monde par le biais de cette alternative au système actuel. Même s’ils doivent supporter un surcoût minime, ils peuvent ainsi se rendre compte de la culture, de l’identité et des conditions de vie des producteurs. Cette économie solidaire place l’homme au centre des occupations et non des profits en l’éduquant au développement durable.
Le commerce équitable entend donc intervenir comme un « complément » au commerce international traditionnel.

b) Quel sont les apports positifs de ce type de commerce pour les économies sous-développées ?
Si le commerce équitable existe, c’est en premier lieu pour favoriser les organisations participatives, respectueuses de la liberté d’expression et de l’avis de chacun sans discrimination aucune. Dans un groupe, ceci se traduit par une prise de décision démocratique, ou dans une entreprise, par la négociation entre patronat et syndicats. Mais plusieurs autres points peuvent d’être énumérés. Le commerce équitable fait vivre 800 000 familles de producteurs, soit 5 millions de personnes dans plus de 45 pays. Il permet à ces personnes du Tiers Monde de percevoir une rémunération décente de leur travail, et pour certains de rentrer dans des logiques de diversification et de financement d’un meilleur accès à l’éducation et aux soins de leur famille. Le commerce équitable est donc la clé d’un développement à long terme.
Il est ensuite un support financier pour ces pays. En effet, beaucoup de petits producteurs et d’artisans n’ont pas accès au crédit, or les organisations du commerce équitable leur offrent des possibilités de financement et de pré-paiement des récoltes ou les mettent en contact avec d’autres sources potentielles de financement. Alors que la plupart des importateurs attendent 60 à 90 jours pour payer leurs fournisseurs, les organisations du commerce équitable fonctionnent avec un système de préfinancement.
Le commerce équitable apporte également un soutien technique aux petits producteurs, en leur donnant dans un premier temps, des informations sur les marchés, sur les normes de santé et de sécurité, sur les produits consommés et sur la gestion de leur production afin que les producteurs puissent adapter celle-ci, puis, en établissant des relations à long terme et en les aidant à s’adapter aux nouvelles tendances du marché qui concernent les petits producteurs.
Un autre aspect positif du commerce équitable est qu’il vise à l’élimination du travail des enfants en utilisant les moyens les plus adaptés et dans l’intérêt de l’enfant. Le travail des enfants ne peut être toléré que dans une période transitoire ou dans le cadre d’un programme de scolarisation ou de formation professionnelle. Mais certains organismes de commerce équitable n’interdisent pas de façon systématique le travail des enfants. Par contre, ils mettent en place des projets qui permettent d’améliorer la vie de nombreux enfants, et sont parfois en adéquation avec certaines des solutions proposées par l’UNICEF pour lutter contre l’exploitation des enfants (renforcer l’éducation, donner aux pauvres des moyens d’agir, faire campagne pour que les entreprises prennent mieux conscience de leur responsabilité propre et de celle de leurs sous-traitants...).
Au nord, les produits équitables sont de plus en plus présents dans les grandes surfaces, ce qui est une condition essentielle pour accroître les parts du marché équitable et rendre ces produits plus accessibles à tous.
Finalement, et c’est un point qui renforce le fait que le commerce équitable s’inscrit dans le cadre du développement durable, ce type de commerce contribue à la protection de l’environnement. Beaucoup d’organisations du commerce équitable travaillent ainsi avec des petits producteurs qui sont implantés dans des régions à forte biodiversité et travaillent avec eux au respect des ressources naturelles en leur donnant des directives pour protéger l’environnement. Ces pratiques visent à laisser une planète propre aux générations futures. Dans la majeur partie des cas, les petits producteurs du commerce équitable n’utilisent ni engrais, ni pesticides, qui sont trop onéreux mais valorisent plutôt des savoir-faire traditionnels, respectueux des équilibres sociaux et environnementaux. La hausse de la productivité dans l’agriculture et l’enrichissement du milieu rural dans les pays défavorisés sont, par ailleurs, deux conditions favorables au développement des petits producteurs.
Le commerce équitable constitue une de ces écoles où se forge une nouvelle quête de sens : à la fois de haut niveau étant donné la qualité du travail effectué, et symbolique, tant il est vrai que, dans des conditions politiques présentes, ce type d’action ne peut s’étendre à la totalité, voire à l’essentiel, des circuits commerciaux. Mais se désengager de l’économisme, penser et agir en termes de dignité et non plus de croissance, voici qui change des drogues habituelles. Respect de la dignité du producteur du tiers-monde et donc, par voie de conséquence, de celle du consommateur ; prise en compte, dans les termes de l’échange, du niveau de revenu, mais également de la liberté d’association, du bien-être collectif, du respect de l’environnement ; éducation de l’acheteur, dont la démarche devient un choix de société... Ces idéaux ne planent pas dans les esprits d’aimables utopistes. Il est désormais établi que le commerce équitable a droit de cité et qu’aux rapports de force entre Nord et Sud peuvent se substituer des relations tournant le dos à l’exploitation.
Tous ces critères favorisent la construction d’une mondialisation qui se veut plus citoyenne. C’est dans le même état d’esprit que Joseph E. Stiglitz, Prix Nobel d'économie, déclare dans La grande désillusion : “ Prendre soin de l'environnement, faire en sorte que les pauvres puissent dire leur mot dans les décisions qui les touchent, promouvoir la démocratie et le commerce équitable : tout cela est nécessaire pour concrétiser les bienfaits potentiels de la mondialisation.”
c) Quels sont les problèmes rencontrés et les limites de ce système ?
Malgré ses apparences louables et justes, le commerce équitable rencontre certains problèmes qui limitent un fonctionnement efficace. Le prix payé au producteur n’explique tout d’abord que pour une faible part le prix final des produits, compte tenu des coûts (et des marges), au niveau du transport, de la transformation, du conditionnement et de la distribution. De plus, il ne faut pas attendre trop du commerce équitable car celui-ci ne peut suffire à permettre une réelle sortie du sous-développement. D’autre part, la demande n’est pas assez forte en Europe malgré sa progression : au sein d’une même région, on voit apparaître de toutes petites bulles de prospérité dans un contexte général où la grande pauvreté domine. La capacité du commerce équitable à insuffler un développement, par le biais de l’enrichissement des communautés paysannes est donc limitée. On peut aussi insister sur le fait que le commerce équitable ne constitue qu’un faible pourcentage du commerce total : selon le rapport de Fair Trade, le volume des produits faisant l'objet d'un commerce équitable s'élève à quelques 200 millions d'euros, soit à peine 0,1% du commerce européen avec le Tiers Monde et seulement près de 1% du commerce mondial. L’Afrique et l’Asie du Sud-Est occupent, au reste, encore une place mineure dans ce processus. Certains vont même jusqu’à dire que ce commerce, dit "équitable", est inéquitable. Ils appuient leur raisonnement sur le fait que, pour qu'un échange soit réellement équitable, les conditions de protection sociale et de rémunération des individus qui produisent doivent être identiques à celles des personnes qui consomment, or, ce n’est pas le cas. En outre, bon nombre de difficultés hypothèquent encore un développement optimal du commerce équitable. On peut citer la modification du mode d'organisation sociale des producteurs (traditions de "clientélisme", pratiques mafieuses, détournement des circuits commerciaux…). Ensuite, on observe l’institution, dans certains cas, de taxes additionnelles dans les États producteurs (effet "confiscation" de la politique fiscale). Dans certaines surfaces de distribution, la signalisation des produits issus du commerce équitable est absente, ce qui ne permet donc pas de les démarquer des autres produits. Il n’existe également pas de structure "institutionnelle", habilitée à encadrer le système du commerce équitable, qui repose exclusivement sur une base associative. Finalement, le surcoût du produit est au final intégralement reporté sur le consommateur. Or, cette difficulté pourrait être contournée par la mise en place d’un système de déduction fiscale pour achat équitable, sur le mode de déduction d’impôts existant pour les dons à des associations caritatives. Ce dispositif présenterait le double avantage d’un coût quasi nul pour les finances publiques (sur la base d’une estimation calculée sur le taux de consommation actuelle des produits du commerce équitable en France) et d’un affichage politique et symbolique fort du gouvernement français en faveur du commerce équitable.
Dans le cas de Max Havelaar, des abus sont dénoncés par certains journalistes. En se repenchant sur le parcours de Max Havelaar, on peut s’interroger sur l’équité véritable de ce commerce. Malgré des buts honnêtes, la loi du marché et le capitalisme semblent avoir brouillé certaines valeurs du commerce équitable. Lorsque ses fondateurs (Frans Van Der Hoff et Nico Roozen) ont tenté de convaincre les torréfacteurs mondiaux de changer leurs pratiques (à l’égard des petits paysans), ces derniers se sont réfugiés derrière la «dure loi du marché ». Les centrales d’achats des supermarchés, n’ont été prêtes à jouer le jeu que leur proposait Max Havelaar, à une condition : qu'on ne remette pas en cause leurs fameuses “marges arrière” (commissions supplémentaires exigées par les hypermarchés sur le chiffre d'affaires des industriels), appliquées à l'ensemble de leurs fournisseurs. Pour accorder ainsi une rémunération plus décente aux petits producteurs pauvres, il n’a donc rien fallu demander aux torréfacteurs. C'est donc le consommateur qui paiera le prix de la bonne conscience retrouvée. En fait, les deux initiateurs ont conduit leur affaire au détriment d'une autre catégorie d’acteurs, les intermédiaires locaux. C’est Max Havelaar qui jouera désormais le rôle de l’intermédiaire, réalisant ainsi une fausse économie sur le dos des petits négociants, permettant de verser 0,08 € à la coopérative mise en place par Max Havelaar et 0,05 € à Max Havelaar lui-même ! Dans son rapport « Une tasse de café au goût d'injustice », l'Oxfam dénonce les conséquences désastreuses de la disparition des négociants de café. Les petits intermédiaires ont perdu leur principale source de revenus. La maîtrise du modèle Max Havelaar semblerait donc avoir échappée à ses fondateurs historiques. Et derrière les ambassadeurs du commerce équitable, les transnationales de la torréfaction et de la distribution poursuivent leur petit commerce destructeur. Mais Max Havelaar n'en est pas moins une immense réussite commerciale. En effet, les produits Max Havelaar sont partout. Des produits équitables. Vraiment? La question interpelle. C’est ainsi qu’on dénonce la méthode Max Havelaar, qui, pour donner généreusement 0,39 € de plus au petit producteur, demande au citoyen-consommateur de payer... 0,46 € de plus pour le même paquet de café frappé cette fois du logo de la marque Max Havelaar. De ce café « équitable » à un véritable commerce éthique, respectueux tout au long de la filière de l'homme et de son environnement, il y a encore bien du chemin à faire. Mais aujourd'hui, à défaut de permettre aux petits producteurs de tirer leur épingle du jeu, ce sont les transnationales de la torréfaction, de la grande distribution et les start-up médiatisées, qui sont les grandes bénéficiaires de ce business prospère.
II. Du petit producteur au consommateur
a) Du cacao au chocolat équitable
Et si,... ces deux tablettes de chocolat, d’aspect pourtant semblable et au gôut similaires, contenaient deux messages politiques opposés, deux histoires divergentes ? Et si, de fil en aiguille, non point en théorie, mais grâce à des actions patientes, lentes, relevant le moins possible de l’amateurisme et du bricolage, se dévoilaient, jusqu’à la plus crue des nudités, les ressorts iniques de l’échange inégal ? Et si, ce constat établi, et de nouvelles pratiques esquissées, la réflexion en venait à investir par capillarité des espaces contigus : nos systèmes d’information. Entre “ chocolat ” et “ chocolat équitable ”, le consommateur français peut désormais faire son choix. Une nouvelle gamme de chocolat labellisée trouve sa place dans les rayons, pour le plaisir de tous et le bénéfice des producteurs. Cacao, sucre, arôme, noisette, lait… Tous ces ingrédients mélangés donnent du chocolat. Et quand cacao et sucre sont équitables, on parle alors de chocolat équitable.
On aime le chocolat depuis la nuit des temps. Jadis boisson sacrée du dieu des Aztèques, il fut découvert par les européens au XI ème siècle. La culture de cacao s’étendit alors de l’Amérique à l’Afrique puis à l’Asie.
Aujourd’hui, sur les 2,9 millions de tonnes produites annuellement, 90 % sont destinées à la consommation des pays occidentaux. Cependant, le problème de la survie des petits planteurs se pose avec insistance. Prés de 2 millions de personnes vivent de la culture du cacao et 90 % de la production mondiale est le fait de paysans possédant moins de 5 hectares. Les problèmes rencontrés par les producteurs de cacao rejoignent ceux des caféiculteurs : prix trop bas, du fait de la spéculation et de la surproduction mondiale, pression des nombreux intermédiaires, difficultés d’accès au crédit. Par conséquent, le commerce équitable offre des réponses parallèles à celles adoptées pour le café : prix minimum garantit, prime de développement, possibilité de préfinancement, et bien sûr, achat direct par l’importateur. Créée en 1994, la filière équitable du cacao accompagne aujourd’hui 50000 producteurs de 8 coopératives dans 8 pays (Belize, Bolivie, Cameroun, Costa Rica, Équateur, Ghana, Nicaragua, République dominicaine). En Europe, 11 pays assurent les débouchés du chocolat équitable. Les ventes de cacao représentaient prés de 1500 tonnes en 2001, soit de 27 % de plus qu’en 2000.
En ce qui concerne la fabrication du chocolat, plusieurs étapes sont necessaires à la transformation du cacao en chocolat. Les fèves de cacao sont d'abord triées, nettoyées et mises à fermenter sur place de 4 à 6 jours. On procède ensuite à une deuxième fermentation. La pulpe alcoolisée se transforme en vinaigre. La fève est nettoyée et on stoppe sa fermentation. Les fèves sont alors séchées et c’est là que commence le travail des femmes, qui font éclater entre leurs doigts les grumeaux de fèves agglomérées, enlèvent les fèves noires, c'est-à-dire pourries qui peuvent contaminer le lot ainsi que les débris de rafle. Puis vient l'étape du brassage qui s’opère grâce à des systèmes à air chaud et l’étape du calibrage. Les fèves plates ou malingres seront destinées à finir sans gloire dans la poudre et le beurre de cacao. Les autres seront mises en sac pour être expédiées aux grands maîtres torréfacteurs de la chocolaterie comme on le fait pour le café. Cette dernière étape permet d'exacerber les parfums avant de concasser les fèves et de les décortiquer afin d'en extraire les amandes. Par ce procédé, on évacue l'humidité et on ouvre les arômes. Les grains passent ensuite au concassage, stade où l’on sépare la graine de la coque. Au broyage, les débris sont enlevés. Les graines sont transformées jusqu'à l'obtention de la pâte de cacao amère. Sous la chaleur, et la pression, le cacao libère ses graisses qui constitue environ la moitié de son poids. Ici, l'arôme croît et l'amertume diminue. Pour l'étape du pétrissage, on incorpore du beurre de cacao et du sucre. C’est là que l’on procède alors au "conchage", c'est-à-dire un brassage à chaud à 80°C pendant toute une journée. Pour le chocolat de luxe, le chocolat fin, le procédé peut prendre jusqu'à 5 jours. La cristallisation du beurre par chauffage apporte au chocolat toute sa brillance. Il suffit alors de le verser dans les moules.
b) La coopérative El Ceibo en Bolivie
La coopérative El Ceibo fut créée en 1981, suite à l'exode massif qu'avait connu la Bolivie dans les années 1970, où plusieurs milliers de familles avaient migré vers la région des plaines en raison de l'infertilité des hauts plateaux. El Ceibo, initiée par une dizaine de paysans de la région de " Las Yungas " ( l'Amazonie Bolivienne ) a pour objectif de promouvoir le développement économique et l'activité commerciale des petits producteurs de la région.
El Ceibo est aujourd'hui un regroupement de coopératives locales de la région de Las Yungas, dans une zone située à 300 km au nord de La Paz. 37 coopératives, comptant chacune une vingtaine de membres en moyenne, composent El Ceibo, soit un total de plus de 650 familles qui bénéficient indirectement de cette aide. La coopérative d'El Ceibo s'est constituée historiquement autour de la ville de Sapecho située à environ 500 mètres d'altitude, dans une zone tropicale, proche de l'Amazonie. Les principales cultures y sont les oranges, les bananes, le riz et le cacao. Le cacao et les bananes constituent les deux cultures d'exportation les plus importantes pour les producteurs, leur assurant des revenus tout au long de l'année. Il s'agit d'une zone enclavée possédant très peu d'infrastructures, desservies par des pistes en très mauvais état. A titre d’information, l'électricité y a été installée seulement en 1998.
Le principal handicap pour les producteurs étant la variation des cours des produits agricoles, El Ceibo constitue un recours stable pour les producteurs en achetant l'ensemble de leur production de cacao à des cours élevés grâce notamment à l'appui du commerce équitable. La principale activité d'El Ceibo est l'aide à la production, à la transformation et à la commercialisation de cacao Biologique. Afin de mieux valoriser le cacao, l'ensemble des membres se sont engagés dans l'agriculture biologique. El Ceibo est administrée par un conseil élu par les représentants des 37 coopératives membres et compte plus de 80 salariés. Ceux-ci, tous membres des coopératives locales, sont désignés par le conseil pour venir travailler à La Paz où est situé le principal centre d'El Ceibo. Ils sont chargés de garantir l'assistance technique aux membres sur la manière de cultiver le cacao, le développement de pépinières, la valorisation des sols et la densification des champs de production. L'assistance technique aux membres comprend aussi la formation aux grands principes de la comptabilité et à la gestion administrative des plantations de cacao, le contrôle qualité, et surtout la transformation du cacao en poudre, en pâte et en beurre de cacao. L'usine d'El Ceibo de La Paz est exemplaire tant par sa capacité de production que par la maîtrise des aspects techniques de production afin de garantir la meilleure qualité de chocolat. L'apport d'El Ceibo est essentiel pour les coopératives locales qui n'auraient sinon pas d'opportunité d'exporter leur produit ou de le vendre sur le marché local à un prix décent.
Aujourd'hui, El Ceibo vend chaque année plus de 1 million d'euros de cacao transformé à l'export et 500 000 euros sur le marché local, pour une quantité totale de 500 tonnes annuelles. La coopérative représente à elle seule plus de 70 % du cacao biologique produit en Bolivie. C'est une réussite remarquable qui permet entre autres de mieux maîtriser la fixation des prix du cacao biologique sur le marché national. La coopérative s’est fixée plusieurs objectifs, à savoir, l’augmentation de leur capacité de production et de transformation et l’amélioration de la rentabilité de l'organisation.
El Ceibo a également développé un grand nombre de produits finis pour le marché local, comme des biscuits ou des tablettes de chocolat, adaptés aux goûts des consommateurs boliviens. Ainsi, El Ceibo maîtrise l'ensemble de la chaîne de production, ainsi que la commercialisation des produits puisqu'elle a déjà ouvert trois points de vente à La Paz. La diversification des produits est aussi encouragée avec le développement de produits comme le café, les épices et les fruits séchés, pour l'instant vendus uniquement sur le marché local. Enfin, la coopérative mène des actions de lobbying pour défendre les intérêts des petits producteurs auprès des instances gouvernementales locales et nationales, en partenariat avec des associations locales et de solidarité internationale.
El Ceibo est donc une coopérative modèle du Commerce Equitable, elle contribue directement à l'amélioration des conditions de vie des petits producteurs en respectant l'ensemble des critères comme le préfinancement des commandes et la fixation d'un prix minimum garanti tout au long de l'année.
Le cacao des chocolats, vendus sous la marque “Alter Eco”, est transformé sur place, puis exporté en Suisse où l’on effectue le conchage* et le moulage, en y associant du sucre de canne des Philippines ( provenant d’une autre coopérative du Commerce Equitable aux Philippines). Le conditionnement est aussi réalisé en Suisse, afin de garantir une excellente qualité gustative et un contrôle d'hygiène reconnu.
Conclusion
“Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité.”
Le commerce équitable est un nouveau modèle économique, qui tente de rééquilibrer les inégalités nord-sud. Il garantit une amélioration de la qualité du produit, avec l’achat de la matière première à un prix estimé juste. Le commerce équitable présente une valeur ajoutée certaine pour les producteurs des pays pauvres et une alternative possible au commerce actuel. Quotidiennement, le modèle est prouvé sur le terrain. Il présente de très forts potentiels de croissance, particulièrement à travers son introduction dans les grandes surfaces. Cette croissance des volumes est nécessaire pour faire face à l’accroissement des capacités de production, des réseaux de producteurs du commerce équitable. Après une première phase de mise en place, l’heure est à présent au développement économique à une taille significative du concept.
Il existe différents enjeux au niveau de la maîtrise de critères (standardisation, quantification, hiérarchisation), de la maîtrise des coûts (augmentation des volumes et optimisation entre surcôut, volume de vente, niveau de marge, élasticité du prix) et de la transparence (système de traçabilité total du produit). Le respect de ces trois critères va conduire au succès du commerce équitable, au service du développement humain. Tous ont un rôle à jouer pour la mise en place harmonieuse de ce commerce, à un champ plus large. Le commerce équitable est un modèle durable au niveau de la création de la valeur économique car il pose moins de problèmes à l’environnement écologique et social mondial. Il passe par un changement de la mentalité de la société.
Seulement, sa situation reste fragile vu l’ampleur des défis à relever. C’est ainsi qu’on pointe du doigt certains problèmes, ce qui ne remet pas en cause le commerce équitable mais qui tend par la capacité à accepter la critique, à recevoir la contradiction, à engager un débat, et par là, à mettre en place d'une démarche évolutive. L’identification des limites du commerce équitable pourra éventuellement contribuer à les dépasser. Le commerce équitable reste, avec toutes ses limites, contradictions et imperfections, un moyen d'action individuel et collectif quotidien pour la mise en place d'échanges plus justes.
Le commerce équitable a encore de l’avenir, il est le commerce de demain et bénéficiera à tous. Il faut donc persévérer dans cette nouvelle forme de commerce en essayant de réviser les facteurs qui lui font défaut pour que le COMMERCE EQUITABLE soit et continue d’être un pari réussi au niveau commercial et sur le développement humain des populations du sud.
Dignité pour eux Qualité pour nous
Equité pour tous